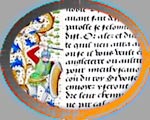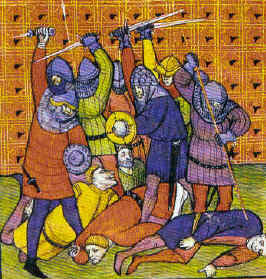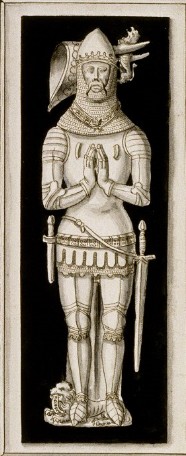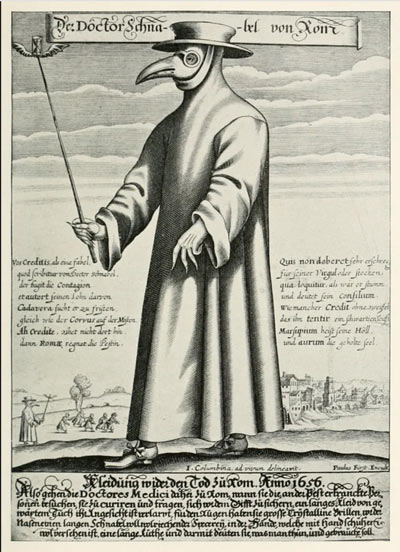capitaine de la guerre de Cent Ans
et le contexte de cet épisode de la Guerre de Cent Ans
Nous sommes en 1358. La guerre de Cent Ans oppose le roi d’Angleterre Édouard III et le roi de France Philippe de Valois, puis son fils Jean le Bon. Elle avait débuté en 1337. Elle dura 115 ans, pour s'achever en 1422.
A - Les Anglais et les Navarrais En 1322, le roi de France, Philippe V, petit-fils de Philippe-le-Bel, meurt sans héritier. Charles le Mauvais, roi de Navarre, et Édouard III, roi d’Angleterre sont petits-fils de Philippe-le-Bel par les femmes et Édouard III, en plus, neveu des derniers rois de France, prétendent chacun au trône de France. Or, en France, la loi salique exclue de la succession au trône, les femmes incapables juridiquement. Les Pairs de France décident alors de changer de dynastie et de désigner un troisième candidat plus éloigné, un cousin de la branche cadette des Valois, Philippe de Valois. Il sera dénommé le roi « trouvé ».
Charles le Mauvais, roi de Navarre, fait alliance en 1354 avec Édouard III en concluant un pacte avec le duc de Lancastre, son représentant : Charles le Mauvais soutint les prétentions d'Édouard III sur la couronne de France et il héritera en retour de la Normandie, de la Champagne et du Languedoc.
En 1358, au moment de nos récits, le roi de France est Jean le Bon. Il est prisonnier à Londres d’Édouard III. Son fils, le Dauphin, duc de Normandie qui deviendra Charles V, a fui Paris.
B - La Bretagne est-elle impliquée ? Pas directement.
La Bretagne sortait d'un siècle de paix, une administration ducale solide et un trésor ducal bien rempli, lorsque le duc Jean III meurt sans héritier et sans désigner son successeur. Le roi de France de l’époque, Philippe de Valois, aimerait récupérer ce duché indépendant. Oubliant les conditions (la loi salique) qui lui avait permis d’accéder au trône de France, il déclare que, comme en Bretagne cette loi n’existe pas les femmes sont héritière. Il autorise Charles de Blois à prêter l’hommage à son égard comme duc de Bretagne au titre d’époux de Jeanne de Penthièvre et confisque à Jean de Monfort son comté de Monfort l’Amaury. Si en effet, les femmes bretonnes sont autant héritières que les hommes (par exemple, les duchesses de Bretagne, Constance (1161-1201) ou Anne (1477-1514), Jeanne de Penthièvre, comme nièce n’avaient pas plus de droits que n’aurait eus une sœur du duc. Ainsi, Jean de Monfort (1339-1399), demi-frère du duc décédé, affichait une priorité incontestable et duc légitime en droit breton. Montfort sollicite alors la protection d’Édouard III, contre les visées de Charles de Blois et du roi de France.
Ainsi, cette guerre civile voit les Bretons du parti du duc légitime soutenu par les Anglais lutter contre des Bretons du parti de Charles Blois nommé par le roi de France. Allons un peu plus loin pour comprendre la fin de l’histoire de Radigois de Derry, compagnon de Knolles. Jean IV gagnera cette guerre et la question de sa succession sera réglée au 1er traité de Guérande en 1365. Cependant, des Anglais sont restés, ils ont reçu des terres en remerciements. La population les hait. Un ami du duc, Guillaume de Saint-André l’interpelle : « trop avez d’Anglais entour de vous / ne peuvent bien être à vous / ils ne aiment ni peu ni prou /nous les haïssons mortellement. » En 1358,le futur Jean IV est à Londre sous la protection d’Édouard III. En combattant pour Édouard III, Radigois l'Irlandois est du parti du duc de Bretagne, contrairement à Duguesclin qui lutte contre lui, pour le compte du roi de France. |
|
|||
|---|---|---|---|---|
Sources photographiques : http://www.pourlhistoire.com ; Wikipedia |
|---|